- underground
-
underground [ ɶndɶrgraund; œ̃dɛrgr(a)und ] adj. inv. et n. m.• 1967; mot angl. amér. « souterrain »♦ Anglic. Se dit d'un mouvement artistique d'avant-garde indépendant des circuits traditionnels de diffusion commerciale. La bande dessinée underground. Des films underground. — N. m. L'underground américain. Des undergrounds.
● underground adjectif invariable (américain underground, souterrain) Se dit de spectacles, de films, d'œuvres littéraires, de revues d'avant-garde, réalisés en dehors des circuits commerciaux ordinaires. ● underground nom masculin Le monde de la contre-culture.undergroundadj. inv. et n. m. inv. (Anglicisme) Qui est réalisé, qui est diffusé en dehors des circuits commerciaux traditionnels, en parlant de certaines productions intellectuelles et artistiques. Presse, bande dessinée underground.|| n. m. inv. L'underground français.⇒UNDERGROUND, subst. masc. inv.Ensemble de productions culturelles, artistiques à caractère expérimental, situées en marge des courants dominants et diffusées par des circuits indépendants des circuits commerciaux ordinaires. Cette fois, on fait de l'Underground de luxe, avec des marginaux qui remplissent les caisses (L'Express, 19 avr. 1976, p. 42, col. 3).— P. méton. Ensemble des mouvements, des personnes qui contribuent à ces productions. Quant à l'autre Mick, milliardaire en transit dans les capitales du Jet Set, il vit des nuits mondaines en compagnie des têtes couronnées, des veuves d'armateurs et de l'underground officiel (Le Nouvel Observateur, 31 mai 1976, p. 58, col. 3).— Empl. adj. Qui est relatif, qui appartient à ces courants artistiques d'avant-garde. Bande dessinée, cinéma, presse, théâtre underground. Underground ou non, ces militants de la révolution immobile donnent à chacun de leur choc l'éclat du chic (Le Nouvel Observateur, 27 sept. 1976, p. 72, col. 3). Des poèmes qu'il publie [Bukowski] dans le « Los Angeles Free Press », un journal underground qui lui apporte peu à peu une notoriété parmi les étudiants (L'Express, 5 déc. 1977, p. 90, col. 2).Prononc.: [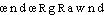 ], [
], [ -], [-
-], [- -]. Étymol. et Hist. 1966 adj. cinéma « underground » (L'Express, 14 nov., p. 84, col. 3); 1967 subst. (Le Nouvel Observateur, 8-14 nov., 40c ds HÖFLER Anglic.). Empr. à l'angl. underground « souterrain » comp. de ground « sol » et de under « sous », prép. fonctionnant comme préf. Att. dep. le XVIe s., d'abord comme adv. puis comme adj. qualifiant des éléments, des choses ou des phénomènes souterrains, underground est att. au fig. dep. la fin du XVIIe s. dans la qualification de qqc. de caché ou de secret, d'où son empl., att. dep. 1939, pour qualifier des groupes ou organisations agissant dans la clandestinité et dep. 1953 pour qualifier ce qui relève d'une culture marginale; de là l'empl. subst. pour désigner un groupe ou un mouvement d'où émane cette culture (v. NED et NED Suppl.2). Comme subst., underground qui désignait des choses souterraines servit en partic. dans l'appellation du ch. de fer souterrain de Londres (1866 the Underground ds NED Suppl.2, d'où un empl. isolé faisant réf. au métro de Londres: usagers de l'« Underground » Le Monde, 23 janv. 1959, p. 8 ds HUMBLEY t. 2 1974, p. 772).underground [œndœʀgʀawnd; œndɛʀgʀawnd] adj. et n. m. invar.ÉTYM. 1966; mot angl. des États-Unis, « souterrain ».❖♦ Anglicisme.1 N. m. Ensemble de mouvements artistiques expérimentaux et semi-clandestins, voulant intégrer toutes les formes d'expression, indépendamment des courants culturels dominants et en marge des circuits traditionnels de diffusion commerciale. || L'underground américain. — Adj. invar. || Cinéma, film, metteur en scène underground. || Bande dessinée underground. || Presse underground. — REM. Le terme est daté (surtout : années 60 et 70).1 À ce stade, la nouvelle école de la bande dessinée mérite bien le nom de « underground » (souterrain) que lui ont donné les Américains lors de son apparition au grand jour : en 1967, à San Francisco. Appellation bien trouvée.le Magazine littéraire, no 95, déc. 1974, p. 10.2 Sur le modèle américain de la presse underground, une presse parallèle s'est constituée en France. Avec 500 000 exemplaires et une centaine de titres, elle publie, à l'échelon local et régional, des informations que les journaux traditionnels négligent.l'Express, no 1096, 6 juil. 1972, p. 36.3 Donc, je ne vois pas en quoi il y a identité sémantique entre « underground » et « contre-culture » ou « culture parallèle ». Il ne peut jamais y avoir identité complète, le terme que vous proposez ne rend plus compte de ce phénomène social et partant vous dites seulement ce que vous, vous en pensez, comment vous, vous voyez l'« underground ».2 N. m. Littér. (emploi d'auteur). Espace « souterrain » de la psyché, inconscient.4 Gisant dans mon underground depuis longtemps mais revenu à la surface il y a peu, ce modèle possible du nom de la petite ville : « Wiesengrund » (…)Michel Leiris, Frêle bruit, p. 158.
-]. Étymol. et Hist. 1966 adj. cinéma « underground » (L'Express, 14 nov., p. 84, col. 3); 1967 subst. (Le Nouvel Observateur, 8-14 nov., 40c ds HÖFLER Anglic.). Empr. à l'angl. underground « souterrain » comp. de ground « sol » et de under « sous », prép. fonctionnant comme préf. Att. dep. le XVIe s., d'abord comme adv. puis comme adj. qualifiant des éléments, des choses ou des phénomènes souterrains, underground est att. au fig. dep. la fin du XVIIe s. dans la qualification de qqc. de caché ou de secret, d'où son empl., att. dep. 1939, pour qualifier des groupes ou organisations agissant dans la clandestinité et dep. 1953 pour qualifier ce qui relève d'une culture marginale; de là l'empl. subst. pour désigner un groupe ou un mouvement d'où émane cette culture (v. NED et NED Suppl.2). Comme subst., underground qui désignait des choses souterraines servit en partic. dans l'appellation du ch. de fer souterrain de Londres (1866 the Underground ds NED Suppl.2, d'où un empl. isolé faisant réf. au métro de Londres: usagers de l'« Underground » Le Monde, 23 janv. 1959, p. 8 ds HUMBLEY t. 2 1974, p. 772).underground [œndœʀgʀawnd; œndɛʀgʀawnd] adj. et n. m. invar.ÉTYM. 1966; mot angl. des États-Unis, « souterrain ».❖♦ Anglicisme.1 N. m. Ensemble de mouvements artistiques expérimentaux et semi-clandestins, voulant intégrer toutes les formes d'expression, indépendamment des courants culturels dominants et en marge des circuits traditionnels de diffusion commerciale. || L'underground américain. — Adj. invar. || Cinéma, film, metteur en scène underground. || Bande dessinée underground. || Presse underground. — REM. Le terme est daté (surtout : années 60 et 70).1 À ce stade, la nouvelle école de la bande dessinée mérite bien le nom de « underground » (souterrain) que lui ont donné les Américains lors de son apparition au grand jour : en 1967, à San Francisco. Appellation bien trouvée.le Magazine littéraire, no 95, déc. 1974, p. 10.2 Sur le modèle américain de la presse underground, une presse parallèle s'est constituée en France. Avec 500 000 exemplaires et une centaine de titres, elle publie, à l'échelon local et régional, des informations que les journaux traditionnels négligent.l'Express, no 1096, 6 juil. 1972, p. 36.3 Donc, je ne vois pas en quoi il y a identité sémantique entre « underground » et « contre-culture » ou « culture parallèle ». Il ne peut jamais y avoir identité complète, le terme que vous proposez ne rend plus compte de ce phénomène social et partant vous dites seulement ce que vous, vous en pensez, comment vous, vous voyez l'« underground ».2 N. m. Littér. (emploi d'auteur). Espace « souterrain » de la psyché, inconscient.4 Gisant dans mon underground depuis longtemps mais revenu à la surface il y a peu, ce modèle possible du nom de la petite ville : « Wiesengrund » (…)Michel Leiris, Frêle bruit, p. 158.
Encyclopédie Universelle. 2012.
